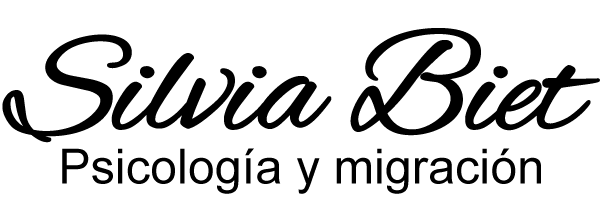Octobre 2025
Le deuil, la perception de soi et le pays d’accueil
Lorsque l’on aborde la migration du point de vue de la psychologie, le thème qui revient le plus souvent est celui du deuil des pertes : ce que nous laissons derrière nous et ce qui nous manque en tant que migrants dans le pays d’accueil.
Parallèlement à l’enthousiasme et au désir d’un nouveau projet, surgit une tristesse qui dérange et envahit les émotions durant la période d’intégration.
Il est tout aussi important d’analyser ce qui se passe dans la relation que l’on entretient avec soi-même à cette période : l’image de soi, le sentiment de sécurité et l’estime de soi.
Le contact avec la nouvelle culture remettra en question le comportement et la vision de la vie du migrant, soulevant des problématiques qui le conduiront à modifier ses réponses. Dans sa tentative de s’intégrer, il pourra changer ou au contraire s’accrocher fermement à ses modes d’être comme à un mécanisme défensif.
La manière dont il est perçu par les autres et la façon dont il se perçoit lui-même dans cette nouvelle société seront différentes de ce qu’il vivait dans son pays d’origine. Ce changement dans la perception de soi entraînera des transformations dans son image personnelle et son estime de soi, et influencera de manière significative le processus d’intégration.
La construction de l’identité et la migration
La construction de l’identité est un processus qui commence à la naissance et se développe au sein d’un groupe familial et communautaire donné.
La socialisation primaire se déroule dans le cadre de la relation que l’enfant établit avec ses parents ou ses figures de soin. Cette relation favorise l’incorporation de valeurs et de visions du monde à travers des processus d’identification.
Le moi et l’image de soi se forgent dans une interaction dynamique avec l’environnement social proche. Les affects facilitent l’apprentissage et l’assimilation progressive du patrimoine culturel du groupe d’appartenance.
La socialisation secondaire élargit et diversifie les relations à mesure que l’enfant, puis l’adolescent, accède à d’autres cercles d’appartenance tels que l’école, le club ou d’autres espaces sociaux. Son identité évolue en même temps qu’il mûrit et traverse des changements biologiques, psychologiques et relationnels. Parallèlement, il prend de la distance par rapport à son noyau familial afin de pouvoir s’individualiser.
Cette construction est un processus complexe et jamais linéaire. Il peut y avoir des moments d’avancée et de recul, comme autant d’étapes logiques. Une relation ambivalente s’établit entre l’appartenance à un groupe par identification et la singularité de l’individu.
Imaginons qu’à une étape de ce long processus, la personne migre et se retrouve dans un environnement culturel différent de celui dans lequel elle a grandi.
Selon l’âge auquel a lieu cette migration, les impacts sur le développement de la personnalité seront différents. Le choc culturel aura des effets variés, provoquant souvent un grand déséquilibre intérieur.
La personne vivra également des expériences intenses liées à la manière dont elle est perçue par les membres de cette nouvelle communauté, expériences qui marqueront inévitablement la différence et le sentiment de non-appartenance.
Être regardé comme un migrant est un fait difficile à assimiler.
Parallèlement, un désajustement interne se produira en même temps que le changement externe, perturbant la perception de soi. Les repères qui procuraient sécurité et estime de soi peuvent changer radicalement dans la dynamique des nouveaux liens établis au sein de la communauté d’accueil.
Le jeune enfant vivra ce changement social et culturel à travers ses parents et, lorsqu’il commencera sa scolarisation, il naviguera entre deux systèmes distincts : la maison et l’institution. Les enfants font preuve d’une grande plasticité et, bien qu’ils s’adaptent généralement rapidement à ces différences, il ne faut pas minimiser le travail psychique que cela leur demande.
Il est intéressant de souligner que chaque espace (maison, école) constitue un système particulier, avec sa langue et ses propres dynamiques relationnelles. Chaque système demeure d’abord isolé de l’autre, puis, avec le temps, ils s’entrelacent comme un reflet du travail interne de l’enfant.
Les figures d’identification de l’enfant en croissance viennent compléter les figures parentales. Dans un environnement multiculturel, ces figures peuvent être très différentes des parents. La distance culturelle entre elles peut devenir un facteur de déstabilisation pour les familles, car les autres membres peuvent ne pas se reconnaître dans les attitudes et comportements de l’enfant.
Il faut préciser que, pendant que se construit l’identité de l’enfant, ses parents traversent eux aussi, chacun à leur manière, le processus d’acculturation.
Lorsque la migration a lieu à l’âge adulte, alors que la personne possède déjà un certain parcours de vie, une histoire personnelle, une personnalité et une image d’elle-même, la migration a d’autres effets psychiques, intellectuels et relationnels. L’identité construite à partir de ses expériences de vie et de son environnement socioculturel et géographique se confronte alors à une réalité différente.
Le choc culturel mettra à l’épreuve ses ressources pour affronter de nouvelles situations et lui fera ressentir la nécessité d’apprendre de ces expériences afin de maintenir un certain équilibre émotionnel et de répondre aux besoins matériels de la vie.
Cet impact provoque du stress et de l’anxiété. Parfois, il peut mener à un état de crise lorsque la personne a le sentiment de ne pas pouvoir faire face à ce travail psychique dans une réalité devenue très hostile.
Le miroir interculturel
Kraven et Patron ont développé le concept de « miroir interculturel » pour décrire la dynamique complexe qui résulte de la manière dont la personne migrante est perçue par l’autre, culturellement différent, et comment ce regard peut lui renvoyer une image très différente de celle qu’elle a d’elle-même.
Si la société d’accueil perçoit et reçoit le migrant avec bienveillance, en valorisant ses aspects positifs et constructifs, cette image du migrant favorisera l’intégration.
À l’inverse, lorsque le migrant est rejeté, perçu comme un délinquant ou un danger pour la société d’accueil, sur la base de stéréotypes et de discriminations, son intégration devient beaucoup plus difficile : il s’épuise à chercher et à formuler les arguments nécessaires pour renverser la narration dominante.
Cependant, il existe de nombreuses situations migratoires où le miroir interculturel permet un changement identitaire positif. Le migrant se libère alors de certaines rigidités et déterminations qu’il portait dans son pays d’origine. Le franchissement de la frontière ethnique lui permet d’exprimer des aspects identitaires plus en accord avec sa vie actuelle.
Un contexte multifactoriel
Il est impossible d’anticiper quels seront les effets et les changements que l’expérience migratoire produira chez chaque migrant. De nombreux facteurs interviennent dans ce processus complexe : des facteurs internes à la personne et des facteurs externes propres à la société d’accueil à un moment donné de l’histoire.
Dans ce texte, j’ai esquissé les différentes dynamiques qui entrent en jeu et auxquelles il faut prêter attention lorsque nous communiquons dans l’interculturalité. Je fais référence non seulement à l’écoute clinique lors d’une consultation psychologique ou médicale, mais aussi à des situations d’apprentissage et d’autres contextes relationnels.
Enfin, dans le processus d’acculturation, deux ou plusieurs communautés culturelles entrent en contact. Dans le cadre de la cohésion et de la paix sociale, les échanges devraient viser à maintenir et respecter le bien-être de tous, dans la mesure des possibilités de la population en général.
Ce défi n’est pas simple, car il existe des rapports de pouvoir entre les groupes. Les intérêts économiques et matériels de certains tendent souvent à primer sur le bien-être collectif, et le recours au racisme sert, de manière fallacieuse, à justifier l’injustice.